Depuis 40 ans, l’association Andar agit en faveur des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, plaçant leur bien-être et leurs besoins au cœur de ses actions. À l’occasion de cet anniversaire, ce dossier propose un regard approfondi sur les évolutions marquantes dans quatre domaines essentiels : la recherche scientifique, la prise en charge des patients, leur implication dans le système de santé et la démocratie en santé, chacune reflétant l’incidence des efforts conjoints entre patients et soignants.
Nous exprimons toute notre gratitude aux auteurs de ce dossier – les Prs René-Marc Flipo, Bernard Combe, Bruno Fautrel, Thierry Schaeverbeke – pour leurs contributions qui témoignent de quatre décennies d’engagement collectif.
Cet anniversaire est l’occasion de célébrer le chemin parcouru et de continuer à bâtir, ensemble, un avenir porteur d’espoir pour tous les patients. Bonne lecture !
Sonia Tropé, directrice de l’Andar
La recherche en rhumatologie et l’exemple de la polyarthrite rhumatoïde
Pr René-Marc Flipo, Sonia Tropé
Les maladies rhumatismales inflammatoires chroniques, notamment la polyarthrite rhumatoïde (PR), touchent plus de 1 % de la population française. Ces pathologies chroniques et invalidantes représentent un défi médical et scientifique important, nécessitant des avancées continues dans la recherche pour améliorer les traitements et la qualité de vie des patients. Des registres à la bourse ANDAR-SFR, la Société française de rhumatologie (SFR) collabore pour faire avancer la science.
La recherche en rhumatologie : un panorama général
Les maladies rhumatismales regroupent une vaste gamme de pathologies, dont la polyarthrite rhumatoïde (PR), une maladie inflammatoire chronique qui affecte principalement les articulations. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans le traitement de ces maladies, grâce à l’émergence des biothérapies et des traitements ciblés, de nombreux défis demeurent.
En France, les grandes études épidémiologiques sur ces pathologies ont été relativement rares, mais elles se multiplient grâce à l’exploitation de bases de données comme le SNDS (Système national des données de santé) qui peut permettre une meilleure évaluation de la fréquence et de l’impact ou poids des maladies. D’un autre côté, il est aujourd’hui un sujet d’intérêt majeur que de s’intéresser à la qualité de vie des patients, notamment à travers la création des PROs (Patient Reported Outcomes) dans les essais cliniques, qui mesurent à la fois l’efficacité et la tolérance des traitements du point de vue des patients.
L’une des avancées majeures en rhumatologie est la stratégie Treat-To-Target, qui recommande un ajustement précis des traitements pour atteindre des objectifs spécifiques, tels que la rémission ou une faible activité de la maladie. Ce modèle a été largement adopté en France notamment grâce à Bernard Combe et Maxime Dougados, très impliqués dans le cadre de l’Eular (European League Against Rheumatism).
Les registres français, comme AIR-PR pour le rituximab, REGATE pour le tocilizumab, ORA pour l’abatacept, ART pour les anti-TNFα et MAJIK pour les inhibiteurs de Janus kinases, jouent un rôle essentiel dans le suivi des effets à long terme des nouveaux traitements.
Cependant, la recherche reste confrontée à un défi de financement, notamment avec la nécessité de diversifier les sources au-delà de l’industrie pharmaceutique. C’est dans ce contexte que les initiatives associatives et les subventions publiques prennent toute leur importance.
L’implication de la Société française de rhumatologie (SFR)
La SFR est donc un acteur clé dans le développement de la recherche en rhumatologie en France. Elle est aujourd’hui la seule société savante qui couvre l’ensemble des thématiques de la spécialité médicale. Elle travaille en étroite collaboration avec certaines autres associations, et notamment le CRI (Club rhumatismes et inflammation). L’objectif principal de la SFR est de favoriser le développement de la recherche en rhumatologie.
Elle joue un rôle central dans le financement de projets collaboratifs et la formation des futurs chercheurs. Par exemple, elle finance des années de recherche pour les étudiants en rhumatologie dans le cadre de leur Master 2, de leur thèse de science (PhD), ou pour des projets de mobilité à l’étranger.
En outre, la SFR a développé des recommandations nationales, souvent en collaboration avec des instances internationales, influençant directement la pratique clinique. Ces recommandations, comme celles sur la gestion de la polyarthrite rhumatoïde, contribuent à améliorer la prise en charge des patients sur tout le territoire. Par ailleurs, la SFR organise des journées de formation continue et le congrès annuel de rhumatologie, rassemblant des spécialistes de la discipline pour échanger sur les dernières avancées scientifiques et thérapeutiques.
Tout ceci passe par une certaine professionnalisation de l’organisation de la recherche en rhumatologie française. C’est en ce sens que la SFR a mis en place un poste de chargé de recherche et que le bureau de la SFR est renforcé aujourd’hui par la présence notamment d’une rhumatologue experte en recherche.
L’implication des associations et des fondations
Grâce aux associations, il est plus facile, par exemple, d’inclure des patients dans les processus de rédaction de recommandations. En principe, les patients devraient être de plus en plus souvent impliqués dans les protocoles même de recherche clinique.
Il y a des partenariats entre la SFR et des fondations ou instituts de recherche. En effet, la SFR est ouverte à de nombreuses collaborations comme pour la journée mondiale des rhumatismes (12 octobre) avec l’Inserm, la fondation Arthritis et les associations de patients. Elle peut être associée à certaines campagnes d’information comme cela a été le cas pour la campagne de sensibilisation au diagnostic précoce de la PR avec l’Andar cette année.
Mais il est clair que la SFR reste d’abord et avant tout une société savante dont l’objectif est de promouvoir la recherche en rhumatologie… ce qui alimente la spécialité notamment au travers de son congrès national, où beaucoup de rhumatologues libéraux sont présents et peuvent accéder aux découvertes comme aux sessions de formation médicale continue.
Polyar’trottons : un exemple d’initiative associative au service de la recherche
La course annuelle Polyar’trottons, organisée par l’Andar, est un bel exemple de mobilisation communautaire au service de la recherche. Cet événement, qui réunit patients, médecins et entreprises, vise à collecter des fonds pour soutenir des projets de recherche en rhumatologie au travers de la bourse Andar-SFR. Cette bourse, la seule financée par une association de malades, est attribuée annuellement et permet de financer des recherches très variées, mais toujours en lien avec la PR. Si l’on se concentre sur les 3 dernières années, il a été question :
• du rôle du microbiote intestinal sur la sensibilisation centrale à la douleur des personnes atteintes de PR,
• du profil des auto-anticorps et du risque familial de PR
• ou encore de l’effet d’une alimentation ultra-transformée sur le déclenchement de la maladie.
L’initiative met en lumière l’importance de l’engagement associatif dans le financement de la recherche. Les fonds récoltés permettent de soutenir des études innovantes qui, autrement, auraient du mal à voir le jour, notamment celles qui nécessitent un financement complémentaire en dehors des circuits traditionnels.
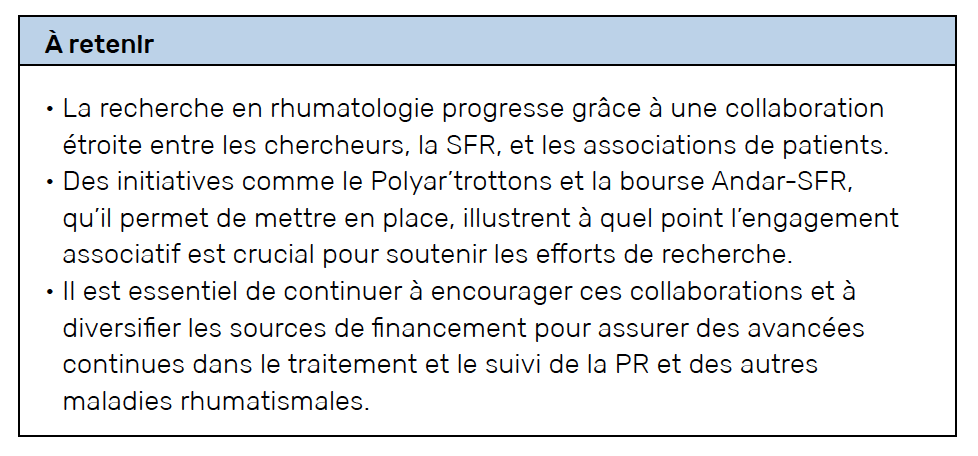
La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde
Pr Bernard Combe
La prise en charge il y a 40 ans
Il y a 40 ans, lorsque l’Andar est née à Montpellier, les traitements qui apportaient le plus de bénéfices pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) étaient la rééducation, les appareillages et la chirurgie orthopédique. Les médicaments étaient proposés pour diminuer les symptômes et comportaient principalement les antalgiques, les anti-inflammatoires, les dérivés de la cortisone et les sels d’or, considérés à l’époque comme le traitement de fond de référence de la maladie en dépit de nombreux effets indésirables. Le diagnostic était empirique, fonction de l’expérience du médecin, et on ne parlait pas de contrôle de la progression des destructions articulaires, qui paraissait inéluctable, ni bien sûr de la mesure de l’activité de la maladie pour laquelle nous n’avions pas encore d’outils validés, ni de contrôle étroit et encore moins de traitement vers la cible, puisque aucun objectif thérapeutique ne pouvait être envisagé, en dehors de “l’aller mieux” et que la rémission était un “graal” que l’on constatait rarement en clinique.
Des progrès considérables
Heureusement, des progrès considérables ont été réalisés au cours du temps. Ceux-ci comportent :
• des avancées scientifiques, permettant de valider des concepts de prise en charge (objectif rémission ou au moins faible activité de la maladie, mesure et contrôle étroit de l’activité de la maladie afin d’ajuster la stratégie, implication du patient dans la décision stratégique dans le cadre d’une décision partagée…)
• et des développements de traitements médicamenteux très efficaces permettant de contrôler l’activité de la PR et d’induire la rémission clinique, de prévenir la dégradation articulaire radiographique ainsi que le handicap fonctionnel, d’améliorer la qualité de vie des patients et probablement de diminuer les risques de maladies générales associées (comorbidités), notamment cardiovasculaires et pulmonaires.
L’établissement de recommandations
Ces avancées majeures ont été organisées grâce à l’établissement de recommandations pour la prise en charge des patients atteints de PR. Ces recommandations ont été nationales (Société française de rhumatologie (SFR), Haute Autorité de santé (HAS)) et internationales (Alliance européenne des associations de rhumatologie (Eular), Collège américain de rhumatologie (ACR)).
Les premières recommandations ont été émises en 2007, mais ont été depuis régulièrement actualisées. Elles ont été rédigées en fonction des données scientifiques disponibles dans la littérature médicale et de l’avis d’experts nationaux ou internationaux. Les patients et les associations de patients ont aussi été invités à participer en tant qu’experts. En France, l’Andar a été la première association de patients à participer aux recommandations de la SFR, en 2014, puis les autres associations ont également été conviées.
Les recommandations de prise en charge de la PR sont heureusement harmonisées entre les données nationales et internationales et sont destinées à la pratique clinique en s’adressant aux rhumatologues, mais aussi à l’ensemble des professionnels de santé et aux patients. Elles ont également un objectif de formation et sont importantes pour l’enseignement des étudiants en médecine et pour la formation continue des professionnels.
Ces recommandations ont permis de guider et d’harmoniser la stratégie de prise charge de la PR et d’informer chaque patient sur les démarches et les traitements les plus adaptés au cours de l’évolution de sa maladie.
La stratégie de prise en charge
Le diagnostic
Les recommandations de la SFR et de l’Eular ont d’abord abordé le diagnostic de la PR à effectuer le plus tôt possible (quelques semaines). Celui-ci repose d’abord sur l’examen clinique, avec identification du ou des gonflements articulaires (synovite = arthrite) et s’aidera de tests biologiques, particulièrement les auto-anticorps anti-protéines citrullinées (ACPA/anti-CCP), qui sont assez spécifiques de la PR, le facteur rhumatoïde (FR) et les anomalies inflammatoires, surtout la protéine C-réactive (CRP). À noter que ces anomalies biologiques peuvent manquer, rendant le diagnostic plus difficile, et que la positivité des ACPA ou du FR peut se voir sans les signes cliniques objectifs d’arthrite, ce qui ne permet pas de retenir le diagnostic et de commencer le traitement. Les radiographies des mains et des pieds sont réalisées, mais sont le plus souvent normales au début et l’échographie articulaire peut aider, surtout quand les signes cliniques sont douteux, en confirmant ou en infirmant les synovites infracliniques.
Le pronostic évolutif
À partir de ces éléments simples, il est possible également de réunir certains facteurs du pronostic évolutif et l’on retient habituellement comme péjoratifs :
• l’importance de l’atteinte articulaire clinique (nombre d’articulations touchées),
• la positivité à taux élevés des ACPA et du FR,
• une élévation importante de la CRP
• et, bien sûr, la présence précoce d’érosions osseuses sur les radiographies, événement heureusement relativement rare au début.
Ces facteurs de mauvais pronostic seront complétés secondairement par la réponse à la première ligne de traitement puis par la réponse au premier traitement biologique.
Les objectifs thérapeutiques
Dès le diagnostic confirmé, il est nécessaire d’établir la stratégie et d’initier un traitement efficace. On définit les objectifs thérapeutiques à moyen et long termes. L’objectif premier est d’obtenir la rémission clinique ou, à défaut, le faible niveau d’activité généralement dans un délai de 3 à 6 mois. Ceci est indispensable pour prévenir les complications à moyen terme que sont les destructions articulaires (surveillance radiographique), le handicap, l’altération de la qualité de vie et les comorbidités, notamment cardiovasculaires.
Les traitements médicamenteux
Première ligne
La première ligne de traitement médicamenteux comporte habituellement du méthotrexate associé à de faibles doses de corticoïdes par voie orale (ou en administrations injectables, ce qui a l’avantage de faciliter l’arrêt). Le méthotrexate doit être utilisé à doses optimales (15-25 mg/semaine). En cas d’impo-ssibilité d’utiliser le méthotrexate, ce qui est rare, ou en cas d’intolérance précoce, l’alternative est un autre traitement de fond conventionnel (csDMARD), le léflunomide ou la sulfasalazine.
Une surveillance stricte de la tolérance et de l’activité de la maladie, mesurée par le DAS28, le SDAI ou le CDAI, doit être réalisée tous les 1 à 3 mois afin d’évaluer la réponse clinique au traitement. La corticothérapie devra être réduite progressivement et arrêtée dans un délai maximum de 6 mois. Si on n’est pas à l’objectif fixé (rémission ou faible activité) dans un délai de 3 à 6 mois, le traitement doit être modifié.
Deuxième ligne et suivantes
En cas d’insuffisance de réponse à ce traitement de première ligne et avec certains facteurs de mauvais pronostic, ce qui est le cas le plus fréquent, il est recommandé de proposer au patient un traitement de fond ciblé soit biologique, soit synthétique (anti-JAK). Actuellement, on commence le plus souvent par un traitement anti-TNF (étanercept, adalimumab, certolizumab, golimumab, infliximab), dont le recul important de commercialisation (20 ans) en fait un traitement de référence pour l’efficacité et la tolérance. Une autre biothérapie (abatacept, tocilizumab, sarilumab) peut également être proposée. Le rituximab est réservé, sauf cas particulier, à un stade ultérieur. Les anti-JAK (baricitinib, filgotinib, tofacitinib, upadacitinib) sont généralement prescrits en troisième ligne compte tenu des conditions de remboursement et des précautions d’emploi dans les populations à risque (sujets de plus de 65 ans, fumeurs, patients à risques cardiovasculaires).
Tous ces traitements ciblés doivent être prescrits, pour une meilleure efficacité, en association au méthotrexate ou éventuellement à un autre csDMARD. Comme pour la première ligne de traitement, une surveillance étroite de la réponse thérapeutique et de la tolérance est nécessaire. En cas d’échec à un premier traitement ciblé, on peut proposer un second traitement ciblé sans qu’il y ait de critère de choix.
Quelle que soit la ligne de traitement, si une rémission prolongée (au moins 6 mois) a pu être obtenue avec arrêt des corticoïdes, on peut envisager une réduction progressive des traitements de fond conventionnels et/ou ciblés, en étant particulièrement prudent chez les patients ayant une PR sévère ou ayant été difficile à contrôler.
Les traitements non médicamenteux
En parallèle au traitement médicamenteux, la prise charge des patients atteints de PR doit comprendre un programme d’éducation thérapeutique, souvent une prise en charge rééducative et des conseils alimentaires et socio-professionnels et, en fonction de chaque cas particulier, une prise en charge psychologique ou, plus tardivement, certaines interventions chirurgicales d’indication moins fréquente actuellement.
L’implication des patients dans l’enseignement, la recherche et la relation de soins : un tournant pour les professionnels de santé
Pr Bruno Fautrel
L’évolution des pratiques médicales et des approches thérapeutiques a progressivement mené à une révision de la place des patients dans le domaine des soins, de l’enseignement et de la recherche. Historiquement, les relations entre soignants et patients étaient fortement hiérarchisées, mais, au cours des dernières décennies, les patients sont devenus des partenaires actifs, contribuant ainsi à améliorer la qualité des soins. De l’importance croissante de l’implication des patients dans la prise de décision médicale à l’incidence sur l’amélioration des soins, l’enseignement des professionnels de santé et la recherche clinique, c’est un véritable tournant que la rhumatologie a vécu tout comme les autres spécialités.
L’évolution de la collaboration entre patients et professionnels de santé
En 2014, une première étape significative a été franchie avec la participation de l’Andar dans l’élaboration des recommandations de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (PR). À cette époque, cette démarche était considérée comme un effort “politiquement correct”. Cependant, au fil du temps, cette implication est devenue une évidence, tant pour les soignants que pour les patients. Aujourd’hui, les représentants des patients des différentes associations jouent un rôle clé dans les discussions entourant la prise en charge des maladies chroniques, en aidant à mieux orienter les débats vers des objectifs concrets et utiles pour toutes les parties prenantes : patients, médecins prescripteurs et équipes soignantes.
La collaboration entre soignants et patients a considérablement évolué depuis les premiers groupes de travail. Initialement, les patients avaient du mal à trouver leur place, face à des discussions souvent techniques et focalisées sur des aspects méthodologiques complexes des essais thérapeutiques. Désormais, les patients sont de plus en plus familiers des données médicales et des résultats des études cliniques, grâce à des initiatives comme la journée annuelle
« Ensemble contre les rhumatismes », les webinaires ou les actions d’éducation thérapeutique organisées par, ou co-organisées avec, des associations de patients.
Cette évolution a permis d’établir une véritable culture du dialogue dans la relation entre soignants et patients. Les réunions de production des recommandations sont aujourd’hui l’occasion pour les deux parties de s’exprimer dans un climat de respect mutuel, avec l’objectif commun d’améliorer la prise en charge quotidienne des patients. Si l’effet direct de cette collaboration sur la qualité des soins reste difficile à prouver, il est indéniable que l’implication des patients contribue à rendre les recommandations plus pertinentes et plus faciles à comprendre pour un plus grand nombre de patients.
Le rôle des patients experts dans le parcours de soins et l’enseignement
Au-delà de la relation de soins, les patients jouent également un rôle croissant dans l’éducation des futurs professionnels de santé. Depuis plus de 20 ans, de nombreuses initiatives ont été prises pour inclure des “patients experts” dans les programmes d’éducation thérapeutique. Ces patients, souvent atteints de maladies chroniques, apportent une perspective unique aux étudiants en santé en partageant leur expérience de la maladie, des traitements et de leur relation avec les soignants.
Cet enseignement, bien qu’initialement accueilli avec scepticisme par certains enseignants, est désormais largement plébiscité par les étudiants, notamment en médecine et en soins infirmiers. Les sessions organisées avec des patients permettent aux étudiants de découvrir une dimension souvent ignorée dans l’enseignement théorique : l’impact humain de la maladie.
Cette complémentarité avec l’enseignement académique est aujourd’hui considérée comme un atout majeur pour la formation des futurs soignants. En intégrant cette approche centrée sur l’expérience des patients, les étudiants sont mieux préparés à comprendre les défis quotidiens auxquels les patients sont confrontés, renforçant ainsi l’empathie et l’écoute dans la relation de soins.
L’implication des patients dans la recherche clinique
La collaboration entre patients et professionnels de santé ne s’arrête pas aux soins et à l’enseignement. Dans le domaine de la recherche, l’implication des patients est devenue un levier crucial pour le développement de nouveaux traitements et protocoles de soins, notamment dans le cadre des maladies chroniques comme la PR. Cet engagement a été fortement encouragé par les autorités de santé, s’inspirant des réussites obtenues lors de l’implication des associations de patients dans la recherche sur le VIH ou les maladies rares.
En rhumatologie, des initiatives telles que le réseau de recherche CRI-IMIDIATE ont permis d’impliquer activement les associations de patients dans la construction des projets de recherche. Ces patients partenaires participent notamment à des sessions de “crash-test” où ils commentent et évaluent les projets avant leur soumission pour financement. Si, au début, les patients étaient réticents à critiquer les projets de recherche, ne se sentant pas légitimes pour le faire, cette dynamique a évolué. Aujourd’hui, les patients partenaires n’hésitent plus à partager leurs perspectives, enrichissant ainsi les projets de recherche d’une vision unique, celle de personnes vivant avec la maladie et susceptibles de participer à des essais cliniques.
Cette collaboration entre patients et chercheurs contribue non seulement à améliorer la qualité des projets de recherche, mais elle renforce également la pertinence des études cliniques en tenant compte des besoins réels des patients. Par ailleurs, l’interaction entre associations de patients et entreprises de recherche clinique (comme l’AFCRO) permet d’accroître l’expertise des patients dans le domaine de la recherche.
Conclusion : un partenariat indispensable pour l’avenir des soins
L’implication des patients dans les domaines des soins, de l’enseignement et de la recherche a transformé la pratique médicale au bénéfice de toutes les parties concernées. Ce partenariat, autrefois perçu comme une simple démarche symbolique, est aujourd’hui une composante essentielle de l’amélioration continue des soins. En intégrant les patients dans les processus de décision, les professionnels de santé parviennent à mieux répondre aux besoins des patients et à rendre les soins plus humains et accessibles. Cela s’est fait par exemple de façon remarquable pour promouvoir les biosimilaires en France : la voix des patients et celle des soignants se sont alignées, permettant de présenter ces thérapeutiques comme une réelle opportunité, utile pour tous.
Le futur de la médecine repose donc sur cette collaboration renforcée, qui allie l’expertise clinique à l’expérience vécue des patients, pour un système de santé plus inclusif et plus efficace.
Quarante ans d’évolution en rhumatologie
Un bilan de l’action associative en faveur de la démocratie sanitaire
Pr Thierry Schaeverbeke, Sonia Tropé
Au cours des 40 dernières années, la rhumatologie en France a connu des transformations majeures, tant sur le plan médical qu’en matière de droits des patients et de démocratie sanitaire. Les associations de patients ont joué un rôle déterminant dans ces évolutions, en influençant les politiques publiques, en facilitant l’accès à l’information et en améliorant l’accès aux traitements. Retracer ces quatre décennies d’engagement permet de mesurer les avancées réalisées et les défis encore à relever.
Les associations, interlocutrices clés des autorités de santé
Depuis les années 1980, les associations de patients se sont imposées comme des partenaires essentiels des autorités sanitaires. En instaurant un dialogue constructif avec les institutions, elles ont mis en lumière les besoins spécifiques des patients. Cette collaboration a abouti à des progrès notables, tels que l’intégration des attentes des malades dans les décisions de remboursement de nouveaux traitements et la participation des associations à leur évaluation.
Les associations ont souvent servi de relais entre les patients et les décideurs, sensibilisant ces derniers aux réalités des maladies chroniques et à leurs conséquences sur la qualité de vie. Cette mobilisation a contribué à façonner des politiques publiques de santé plus proches des besoins concrets des patients.
Représentation politique et accès équitable à l’information
L’un des acquis majeurs des associations a été d’obtenir une représentation au sein des instances décisionnelles, comme le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) ou les commissions de transparence de la Haute Autorité de santé (HAS).
En parallèle, elles ont œuvré pour garantir un accès égalitaire à l’information. Ainsi, l’Andar, avec le soutien de la Société française de rhumatologie (SFR), a lancé des initiatives telles qu’une campagne de sensibilisation au diagnostic précoce de la polyarthrite, touchant 2 millions de personnes (cette campagne est encore disponible sur www.polyarthrite-andar.org). Elle propose également un module d’e-learning gratuit pour aider les patients à mieux comprendre leur maladie et naviguer dans le système de santé, un outil précieux aussi pour les soignants. Ce module d’e-learning est en accès libre sur maformationsurlapr.org.
La loi Kouchner et la reconnaissance des associations
La loi Kouchner de 2002 a marqué une étape cruciale pour la démocratie sanitaire. Elle a formalisé le droit des patients à l’information et à leur participation aux décisions concernant leur santé. Elle a également apporté une reconnaissance officielle aux associations à travers un agrément. Ce statut leur a permis de s’impliquer davantage dans la définition des politiques de santé et de renforcer leur influence auprès des décideurs publics.
Ainsi, l’Andar siège désormais au conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Cette reconnaissance a contribué à transformer la relation entre les patients et les médecins, passant d’un modèle paternaliste à une approche partenariale et centrée sur le patient.
Grâce aux efforts des associations, qui ont favorisé une approche centrée sur le patient et encouragé un dialogue ouvert et transparent avec les professionnels de santé, les patients, désormais mieux informés et plus autonomes, sont en mesure de s’impliquer activement dans les décisions qui les concernent.
Lutte pour l’accès aux biomédicaments : un combat pour l’équité
L’accès aux biomédicaments a été un combat central pour les associations, face à des coûts souvent prohibitifs. Grâce à leur plaidoyer, les associations de patients sont parvenues à mettre fin aux restrictions budgétaires régionales qui limitaient l’accès à ces innovations thérapeutiques. Les biomédicaments sont ainsi devenus plus accessibles, garantissant une prise en charge équitable sur l’ensemble du territoire. L’accès facilité à l’innovation thérapeutique a largement contribué à l’amélioration de l’état de santé de très nombreux patients. Le rôle des associations a été déterminant dans ce changement, en soulignant non seulement les besoins médicaux, mais aussi les dimensions éthiques et sociales de l’accès aux soins.
Depuis 2013, l’Andar et d’autres associations comme France psoriasis militent pour une utilisation réfléchie des biosimilaires. Elles prônent une décision partagée entre patients et soignants et rejettent la substitution systématique par les pharmaciens, tout en soutenant des modèles d’interchangeabilité sécurisés pour préserver l’équilibre du système de santé. Ces actions continues se font également en concertation avec la SFR, mais aussi la CSMF.
L’Andar occupe ainsi l’un des trois sièges associatifs au sein du comité scientifique temporaire de l’ANSM sur la question de la substitution.
Les réformes de la Sécurité sociale et les perspectives
Les évolutions des lois de la Sécurité sociale ont représenté des défis constants pour les associations, affectant directement les soins et la prise en charge des patients. Ces dernières années, des collectifs comme Action Patients, présidé par l’Andar, unissent leurs forces pour défendre les droits des patients face à des systèmes hospitaliers en crise, tout en développant des initiatives comme le premier baromètre des pertes de chance.
Les enjeux sont majeurs pour les années qui viennent. À l’heure où nous voyons poindre une nouvelle révolution thérapeutique dans les maladies inflammatoires, la médecine est confrontée à des défis multiples : financement du système de soin, coût de l’innovation thérapeutique, crise de l’hôpital public, diminution du nombre de spécialistes, accroissement des déserts médicaux… À quoi sert d’avoir des traitements plus efficaces s’il faut plusieurs mois pour obtenir le moindre rendez-vous ?
De nouvelles organisations devront être pensées et développées, les associations doivent évidemment occuper une place centrale dans ce processus.
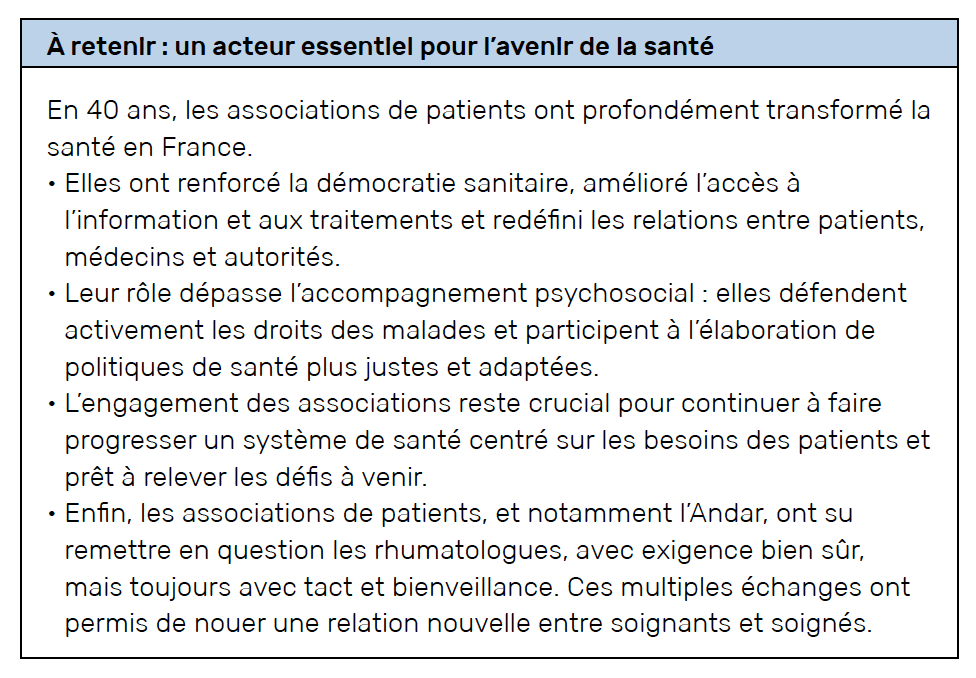
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec ce dossier.




