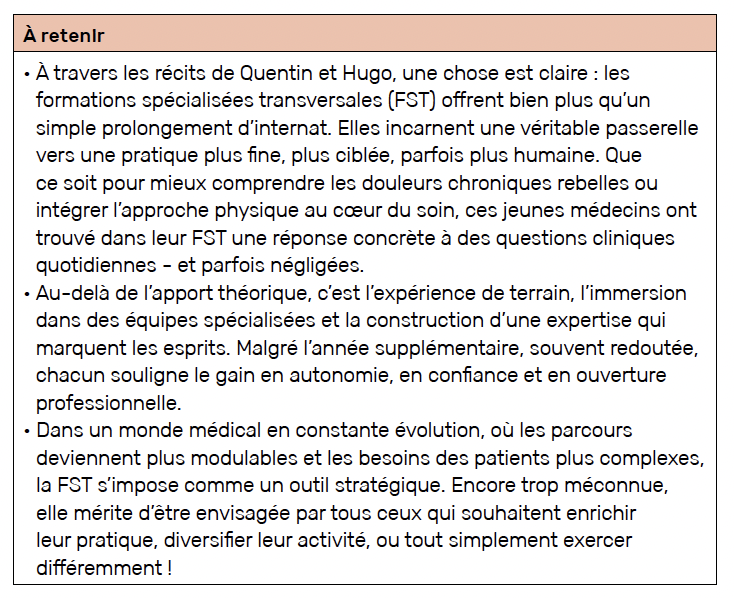Les formations spécialisées transversales
Les formations spécialisées transversales (FST) ont été créées par décret fin 2016 dans le cadre de la modification de l’organisation du 3e cycle des études de médecine, avec une mise en place à la rentrée de novembre 2017, et ce, afin de pallier la disparition de certains diplômes d’études spécialisées complémentaires (DESC). Il s’agit de formations venant compléter le cursus de l’interne à partir de la phase d’approfondissement (soit dès la 2e année d’internat), réalisées à travers une année dédiée. L’objectif est une “sur-spécialisation” ou “expertise”, à la fois dans un objectif personnel d’élargissement des compétences, et dans un objectif commun d’apporter une compétence spécifique au sein d’un service ou d’un réseau professionnel local.
En pratique
Contrairement aux diplômes universitaires (DU), le programme des FST est défini nationalement et elles ne sont pas payantes (inscription facultaire uniquement). Cependant, elles nécessitent une interruption de l’internat pendant 1 an, et on ne peut en valider qu’une seule au cours de son internat.
Il existe un grand nombre de FST, qui peuvent être communes à plusieurs DES, et théoriquement accessibles à tous, avec un nombre de places à l’échelle nationale défini par décret annuel et publié au Journal officiel.
Le choix de la FST doit être validé par le coordinateur du diplôme d’études spécialisées (DES) d’origine, ainsi que par le responsable local de la formation choisie. Les modalités d’enseignement varient selon les formations, incluant des cours en e-learning, des séminaires et des stages pratiques. Cette année est composée de cours théoriques et de deux stages de 6 mois en lien étroit avec la thématique choisie.
En rhumatologie
Tandis que six d’entre elles sont jugées particulièrement adaptées au jeune rhumatologue, les trois FST les plus prisées en rhumatologie sont :
• médecine du sport,
• cancérologie adulte
• douleur,
avec respectivement, en 2024, 71, 154 et 95 places à l’échelle nationale.
Elles sont suivies des FST :
• médecine palliative,
• pharmacologie médicale – thérapeutiques
• et expertise médicale-préjudice corporel,
avec, respectivement, en 2024, 112, 76 et 29 places à l’échelle nationale (JORF n°0097 du 25 avril 2024).
Cette modalité d’enseignement récente est encore méconnue de la plupart des internes en rhumatologie. Fort de cette observation, nous avons recueilli quelques témoignages d’internes ou ex-internes afin de vous offrir un retour d’expérience inédit et, nous l’espérons, inspirer le choix de certains dans les prochaines années ! Nous rappelons que chaque témoignage d’expérience reste personnel.
Le retour de Quentin sur la FST douleur
« Je me sentais frustré, jeune interne, face aux patients […] auxquels on disait : « La maladie est contrôlée, mais vous avez de la douleur », sans pouvoir aller plus loin. » – Quentin
Quentin Jansseune est chef de clinique en rhumatologie au CHU de Caen. Il partage son temps entre le service de rhumatologie et l’équipe mobile douleur et soins palliatifs, où il a une activité de médecin de la douleur.
Par quels moyens t’es-tu renseigné sur les FST ?
Dès le début de mon internat, lors de la journée d’accueil du DES, on nous a présenté les FST. J’ai eu la chance d’avoir un chef de service, coordinateur du DES, qui était également coordinateur de la FST douleur. Il nous en a donc rapidement parlé. De plus, un interne de la promotion précédente avait déjà suivi cette formation, ce qui m’a permis d’avoir un retour d’expérience direct.
Pourquoi avoir choisi une FST plutôt qu’un DU ou un DIU ?
Un DU, c’est très bien en termes de formation théorique, mais la FST a l’avantage de proposer deux semestres de stages pratiques dans des services spécialisés. Cela permet de bénéficier directement de l’expérience de médecins seniors expérimentés. Même si cela rajoute une année d’internat, ce qui peut être rebutant, l’apprentissage pratique en vaut, à mon avis, la peine.
Qu’est-ce qui t’a motivé à choisir la FST douleur en particulier ?
Au départ, c’était par curiosité. Je me sentais frustré, jeune interne, face aux patients en hospitalisation de jour qui présentaient une maladie inflammatoire contrôlée, mais qui restaient douloureux. On leur disait : « La maladie est contrôlée, mais vous avez de la douleur », sans pouvoir aller plus loin. Je voulais acquérir les compétences pour mieux prendre en charge ces patients. Aujourd’hui, grâce à la FST, j’identifie plus facilement les douleurs chroniques, nociplastiques ou “fibromyalgiques”, et j’adapte mes prises en charge dès le départ, sans m’engouffrer dans des rotations de thérapeutiques de fond.
Par ailleurs, la majorité de nos patients viennent nous consulter pour un motif de douleur. De mon point de vue, en tant que rhumatologue, il est important de prendre en pleine considération ce symptôme douloureux, tant par une écoute attentive de celui-ci que par une prise en charge adaptée, “sur-mesure”.
Comment s’est passée la sélection pour cette FST ?
À Caen, cela a été simple : deux postes étaient ouverts et nous étions deux candidats. Pas de réelle concurrence. Les démarches administratives ont été légères, quelques formalités à la faculté. Mon coordinateur de DES m’a guidé et j’ai rencontré le chef de service de l’équipe douleur pour présenter mon projet. Globalement, tout s’est fait facilement.
Plus généralement, la cohérence du projet professionnel et la motivation de l’interne qui postule à une FST sont des éléments importants qui sont pris en compte lors de la demande.
Peux-tu nous décrire concrètement ton année de FST ?
Il faut valider deux semestres, que l’on peut enchaîner ou répartir. J’ai choisi de les faire sur une année complète. J’ai passé un semestre au CETD (Centre d’évaluation et de traitement de la douleur) du CHU de Caen, puis un semestre en neurochirurgie, dans le service spécialisé du rachis. Là, j’avais une vraie place d’interne de FST, tout en gardant mon regard de rhumatologue : consultations rachis, bilans partagés avec les neuro-chirurgiens, participation au bloc… Maintenant, je sais vraiment ce qu’est une arthrodèse et comment cela se passe. Cette expérience m’a beaucoup apporté, tant en connaissances qu’en réseau.
Après, en médecine de la douleur, on se rend rapidement compte qu’on ne connaît pas grand-chose. Fort heureusement, c’était un véritable compagnonnage : jamais seul, toujours encadré, avec possibilité de débriefer.
Bien que les modalités de formation de la FST douleur aient changé depuis peu, me concernant, la formation théorique comprenait un volet national : cours en ligne avec des vidéos, que l’on doit obligatoirement regarder, et des séminaires en présentiel à Paris (deux par an), et même un séminaire interrégional, pour ma région qu’est la région Grand Ouest, tous les 2 ans, avec présentations de cas cliniques et jeux de rôle.
L’évaluation finale repose sur des QCM en ligne.
En termes de difficulté de cet examen théorique, quel est ton ressenti ?
Lorsque l’on s’engage dans une FST, il faut avoir conscience qu’il s’agit d’une année de formation à part entière, avec un volume de cours conséquent. Cela demande de la régularité et de la rigueur. Il ne faut pas prendre la formation à la légère, ni attendre la dernière minute : c’est en travaillant de façon continue que l’on progresse et que l’examen se valide sans difficulté.
As-tu rencontré des difficultés particulières au cours de cette FST douleur ?
Pas vraiment. La charge de travail est différente : beaucoup de consultations, parfois longues et éprouvantes, car les patients racontent des parcours de vie compliqués. C’est donc un peu difficile à assimiler au début.
Par ailleurs, les horaires sont fixes, ce qui change agréablement du rythme habituel de l’internat. Quant aux gardes et astreintes, personnellement, étant affilié à un service de consultation durant cette année de FST, je n’en ai eu aucune durant mes WE. La période était donc plus calme que lors de mon internat de rhumatologie.
Enfin, bien que les cours à distance demandent de la régularité, il était possible de le visionner quand nous le souhaitions. Ce n’était donc pas insurmontable.
As-tu eu l’impression de t’éloigner de la rhumatologie ?
Oui et non. Oui, car on découvre un nouveau domaine, avec des pathologies spécifiques. Non, car une grande partie des douleurs chroniques est musculosquelettique, donc directement en lien avec la rhumatologie (lombalgies, cervicalgies, douleurs neuropathiques, fibromyalgies). Cela m’a permis de mieux considérer les pathologies mécaniques chroniques, moins abordées lors de notre formation. C’était donc globalement très intéressant pour moi.
Quelle est, selon toi, la principale plus-value de cette FST dans ta pratique actuelle ?
Je dirais l’autonomie. Aujourd’hui, face à un patient douloureux chronique, je sais cadrer la situation, distinguer ce qui relève d’une biothérapie de ce qui relève d’une prise en charge antalgique, orienter vers un centre antidouleur si besoin. Cela me permet de prendre du recul et de mieux accompagner les patients.
Par exemple, lorsque je vois arriver un patient avec une pile conséquente de résultats d’examen sur 10 ans, ce qui nous arrive à tous, j’arrive désormais à clairement temporiser, cadrer les choses plus facilement et ne serait-ce qu’initier une prise en charge adaptée à la douleur du patient.
Comment as-tu intégré cette surspécialisation dans ton exercice actuel ?
Je combine les deux (rhumatologie et médecine de la douleur, NDLR). J’ai une activité de rhumatologie classique, centrée notamment sur la pathologie osseuse (métastases, fractures, ostéoporose), mais aussi une activité centrée sur la douleur, en particulier en oncologie. J’apporte un double regard : évaluation du risque fracturaire et expertise sur la prise en charge de la douleur de métastases osseuses dont la prise en charge peut être complexe. J’ai ainsi pu développer une niche professionnelle qui me plaît beaucoup.
Ce que j’apprécie en particulier, c’est la prise en charge de la santé osseuse des patients : ostéoporose, complications liées aux immunothérapies, mais aussi les douleurs séquellaires du cancer. Avec les progrès en oncologie, les patients vivent de plus en plus longtemps, mais se retrouvent souvent, plusieurs années après le diagnostic, avec des douleurs chroniques liées aux traitements, aux chirurgies (arthrodèses, prothèses), ou parfois simplement à une arthrose. Dans ce contexte, mon rôle est d’apporter un regard rhumatologique : rappeler que certaines douleurs ne nécessitent pas forcément de lourds traitements antalgiques, mais peuvent être prises en charge de façon plus classique, par exemple avec de la kinésithérapie ou des infiltrations. J’affectionne particulièrement ce positionnement, à la frontière entre oncologie, douleur et rhumatologie.
Tu nous parles finalement peu de fibromyalgie ou de syndromes douloureux chroniques. Corrige-moi si je me trompe, mais cela ne représente qu’une part restreinte de ton activité ?
Oui, c’est exact, cela reste une part limitée de ma pratique. Mon activité est davantage orientée vers la douleur liée au cancer. La fibromyalgie est bien présente, mais elle ne constitue pas le cœur de mon exercice. La médecine de la douleur ne se résume pas uniquement à la fibromyalgie – qui reste une pathologie fréquente – , même si cette image lui colle encore à la peau. Je pense néanmoins que cette perception évolue progressivement, et j’ai bon espoir qu’elle change durablement.
Est-ce que cette FST t’a ouvert des opportunités professionnelles concrètes ?
Oui. Il y a une vraie demande nationale en médecine de la douleur, beaucoup de départs en retraite sont attendus. La FST ouvre directement la possibilité d’exercer en centre antidouleur, et permet aussi de réduire la durée de la capacité douleur de 2 à 1 an. Beaucoup de rhumatologues pratiquent ainsi une activité mixte : quelques jours de consultations douleur et le reste en rhumatologie.
J’ai également pu m’impliquer dans des projets de recherche, par exemple sur l’activité physique adaptée (APA) dans les douleurs osseuses secondaires au myélome multiple, ou encore sur les douleurs neuropathiques.
Avec le recul, referais-tu le choix de cette FST ?
Oui, sans hésitation. J’ai poursuivi avec la capacité douleur et j’occupe aujourd’hui un poste partagé entre rhumatologie et douleur. Je ne regrette absolument pas ce choix.
Quel conseil donnerais-tu aux internes intéressés ?
Ne pas hésiter à échanger avec des collègues qui ont déjà suivi la FST et à discuter avec les coordinateurs, qui sont généralement accessibles. La médecine de la douleur est passionnante et mérite d’être découverte.
Enfin, une anecdote marquante ?
Mon premier jour en neurochirurgie : j’ai fait un malaise au bloc, et le PH, pensant que j’étais externe, m’a sévèrement recadré ! Heureusement, les choses se sont très bien arrangées par la suite. Mais, c’était une entrée en matière un peu brutale…
« La médecine de la douleur ne se résume pas uniquement à la fibromyalgie – qui reste une pathologie fréquente – , même si cette image lui colle encore à la peau. » – Quentin
La FST médecine du sport vécue par Hugo
« Le principal défi était de débuter dans un domaine que je ne maîtrisais pas encore […], mais en étant encadré, c’est là que l’on se voit progresser. Cette phase d’adaptation devient vite un atout. » – Hugo
Hugo Gondouin est docteur junior en rhumatologie au CHU de Nancy. Il a réalisé une FST de médecine du sport et prévoit, à court terme, de réaliser un assistanat au sein d’un centre universitaire de médecine du sport.
Par quels moyens t’es-tu renseigné sur les FST ?
Principalement via les réseaux sociaux. J’avais entendu parler de la FST de médecine du sport dès le début de mon internat, notamment grâce à des interviews d’internes publiées sur la plateforme La Martingale. L’un d’eux avait justement suivi ce parcours.
Pourquoi avoir choisi une FST plutôt qu’un DU ou un DIU ?
J’ai également suivi le DIU de médecine du sport, mais la FST m’a semblé plus complète. Elle comporte une dimension clinique, avec une immersion de 1 an dans un service spécialisé. Le DU est surtout théorique, alors que la FST permet un véritable apprentissage par la pratique. Les deux formations sont d’ailleurs très complémentaires.
Pourquoi avoir choisi la FST de médecine du sport en particulier ?
C’était avant tout un projet professionnel. Je souhaitais exercer la médecine du sport tout en restant rhumatologue. La FST me permettait d’obtenir le titre de médecin du sport, tout en combinant la rhumatologie classique, centrée sur l’inflammatoire, avec une approche plus mécanique et fonctionnelle propre à la médecine du sport.
Peux-tu décrire concrètement ton année de FST ?
À Nancy, la formation se déroule sur 1 an au sein du Cumsapa, le Centre universitaire de médecine du sport et d’activité physique adaptée. C’est un service rattaché au CHU, qui accueille aussi bien des patients atteints de maladies chroniques que des sportifs. On y réalise des consultations de médecine du sport, des bilans physiologiques, des explorations fonctionnelles respiratoires et des évaluations à l’effort. L’année est donc très pratique, orientée sur la physiologie de l’exercice et l’adaptation de l’activité physique.
Quels freins ou difficultés as-tu rencontrés au cours de cette année ?
Pour commencer, je n’ai pas rencontré de difficultés particulières sur le plan administratif concernant l’inscription, ce qui peut parfois en freiner certains. Le principal défi était plutôt de débuter dans un domaine que je ne maîtrisais pas encore : la physiologie de l’effort, les EFR (exploration fonctionnelle respiratoire), tout cela était nouveau pour moi. Au départ, on se sent un peu en dehors de sa zone de confort, mais en étant encadré, c’est là que l’on se voit progresser. Cette phase d’adaptation devient vite un atout.
As-tu eu l’impression de t’éloigner de la rhumatologie pendant cette année ?
Pas vraiment. J’ai continué à suivre les cours de DES et à garder un pied dans la spécialité. Bien sûr, 1 an sans pratiquer la rhumatologie inflammatoire fait un peu perdre la main, mais les réflexes reviennent vite à la reprise. Cette expérience m’a surtout permis de développer de nouvelles compétences et une autre approche du patient douloureux.
Quelle est, selon toi, la principale plus-value de cette FST dans ta pratique actuelle ?
La FST m’a apporté une meilleure compréhension des douleurs mécaniques et musculaires, parfois moins approfondies en rhumatologie. J’ai affiné mon examen clinique et développé une approche plus globale de mes patients. En somme, elle complète parfaitement la formation classique en rhumatologie, qui est un peu plus axée sur l’immuno-inflammatoire.
As-tu eu l’occasion d’observer l’exercice en libéral ?
Oui, j’ai passé quelque temps dans un cabinet libéral pour voir la pratique quotidienne d’un médecin du sport. Contrairement à la rhumatologie, il n’y a pas de différence majeure entre le libéral et l’hospitalier, hormis l’absence des explorations physiologiques comme les tests d’effort. Les deux pratiques se rejoignent sur le plan clinique.
Comment envisages-tu ton exercice après la FST ?
Mon objectif est de combiner les deux : rhumatologie et médecine du sport. Pour l’instant, je vais exercer à temps plein en médecine du sport, mais je souhaite, à terme, garder une activité mixte. Idéalement, j’aimerais partager mon temps entre consultations de rhumatologie et de médecine du sport, cela demande une bonne organisation pour flécher son activité, peut-être dans deux structures différentes justement.
Quels conseils donnerais-tu aux internes intéressés par cette FST ?
Je pense qu’il faut avant tout être motivé. En rhumatologie, la FST ajoute une année supplémentaire, ce qui peut en freiner certains. Mais c’est une formation très enrichissante, à la fois sur le plan humain et médical. Si l’envie est là, il ne faut pas hésiter : la FST apporte une vraie ouverture et une expertise complémentaire précieuse.
Une anecdote à partager ?
Pas de grande anecdote en tête, mais beaucoup de bons souvenirs au sein de l’équipe du Cumsapa. Ce fut une année dense, mais passionnante, qui m’a conforté dans mon choix de carrière.